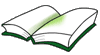|
Résumé :
|
"Pour une grande part de la littérature scientifique internationale, le jeu pathologique est considéré comme une entité récente, instituée comme telle par le DSM III en 1980. Cette nouveauté affirmée doit être le premier objet d'étonnement du chercheur, en ce qui concerne une problématique individualisée depuis l'antiquité. L'étude des différentes dimensions du phénomène (épidémiologie, histoire, sociologie, antrhopologie, études cliniques et propositions thérapeutiques, etc...), montre que les discussions concernant peuvent s'appliquer à l'ensemble des addictions. Celles-ci, dans leur ensemble, ne peuvent être abordées que par des modèles complexes, prennant en compte les dimensions biologiques, personnelles, socio-culturelles... Les auteurs proposent ici un modèle des addictions basé sur les notions de dépendance et de conduite ordalique, qui s'applique particulièrement à la compréhension du jeu compulsif, excessif, ""dostoievskien"", ou jeu pathologique. D'être ainsi situé au centre d'un continuum des différentes addictions elles-mêmes, de la plus ""banale"" comme le tabagisme, à la plus ordalique, comme la toxicomanie actuelles aux drogues illicites, le jeu éclaire les différentes dimensions de ces conduites: dépendance, abandon de soi-même, désubjectivation d'un côté, défi, épreuve, quête de sens de l'autre. A la place ambigue du jeu dans la société répond la complexité, le paradoxe apparent d'une conduite à la fois routinière et transgressive."
|