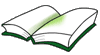|
Résumé :
|
La légalisation des drogues peut être organisée selon des modalités variées et plusieurs systèmes de régulation sont concevables. Une libéralisation totale de tous les stupéfiants, abandonnés à la loi de l’offre et de la demande, n’aurait assurément pas les mêmes effets que l’autorisation de certains d’entre eux, dans le cadre d’un monopole d’État encadré par de rigoureux dispositifs sanitaires. À s’en tenir au cannabis, les rares expériences de légalisation mises en œuvre témoignent de la variété des modèles envisageables. Le législateur uruguayen, par exemple, requiert des consommateurs qu’ils s’enregistrent auprès des autorités et qu’ils s’approvisionnent alternativement dans les pharmacies fournies par l’État, dans des clubs associatifs, ou dans le cadre d’une autoproduction quantitativement limitée. Au contraire, les lois du Colorado s’en remettent largement aux acteurs privés et tiennent l’État à distance du marché, si ce n’est pour en encadrer l’activité et en taxer les bénéfices. Dans les deux cas, la réforme mise en œuvre est trop récente pour en mesurer précisément les effets et pour les imputer au cadre réglementaire choisi. Mais il est déjà possible, en gardant à l’esprit l’incertitude qui caractérise tout exercice de prospective juridique, de spéculer sur les conséquences d’une sortie de la prohibition.Sur le plan juridique, la légalisation des drogues aurait pour conséquence l’abrogation d’un certain nombre d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il en résulterait logiquement une réduction de la délinquance en raison de la fin de l’illégalité attachée à des comportements faisant aujourd’hui l’objet d’une incrimination pénale (on songe par exemple aux millions d’infractions d’usage de stupéfiants commises chaque année en France)…
|