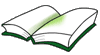| Titre : | Vingt ans de discours médiatiques autour des salles de consommation à moindre risque : analyse textométrique de la presse francophone belge |
| Auteurs : | Roose, Vincent, Auteur ; André, Sophie, Auteur ; JAUFFRET ROUSTIDE M., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Déviance et société, 2024 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; REDUCTION DES RISQUES (ADDICTION) ; BELGIQUE ; CANNABIS ; DROIT PENAL ; REPRESENTATION DE LA REALITE ; REPRESSION ; ETUDE ; LEGISLATION ; SOCIO-ECONOMIE DE LA SANTE ; CONTROLE DES DROGUES ; NORME SOCIALE ; DEVIANCE ; REGULATION DES DROGUES ; INSECURITE ; CRIMINALITE |
| Mots-clés: | TOXICOMANIE ; ADDICTION ; DROGUE ; REDUCTION DES RISQUES (DROGUES) ; POLITIQUE SECURITAIRE |
| Résumé : |
es salles de consommation à moindre risque (SCMR) sont un dispositif relativement récent dans le paysage belge, puisque la première SCMR de Belgique a ouvert ses portes en 2018 à Liège, suivie d’une deuxième en 2023 à Bruxelles. De son côté, la Flandre a, jusqu’à présent, opté pour d’autres dispositifs (Medisch Sociaal Opvangcentrum ; MSOC). Il apparaît donc pertinent de se pencher sur les représentations de ces nouveaux dispositifs, notamment au travers des discours médiatiques en Belgique francophone. La littérature scientifique s’accorde en effet sur le fait que le monde médiatique participe à la construction sociale des représentations des individus (Comelli et al., 2021 ; Duval et al., 2021 ; Erickson, 1991 ; Lancaster et al., 2011 ; McNair, 2018 ; Nišić, Plavšić, 2014 ; Surette, 2011 ; Yar, 2012) et constitue aussi un outil de communication politique (McNair, 2018). La question des drogues et de leurs usages, tout comme celle des dispositifs mis en place pour les encadrer, tels que les SCMRs, ne font pas exception (Comelli et al., 2021 ; Jauffret-Roustide, Cailbault, 2018)[ [1]].
Au cours des quinze dernières années, la recherche empirique a permis de mettre en évidence les bénéfices des SCMRs sur le plan de la santé et de la sécurité publique (Potier et al., 2014). Parmi les résultats, il est possible de citer une réduction des overdoses (Marshall et al., 2011 ; Salmon et al., 2010) ; le rapprochement d’individus isolés et en situation de détresse sociale et/ou financière du système de soins de santé (DeBeck et al., 2008 ; Wood et al., 2006) ; une réduction des dépôts de seringues usagées dans l’espace public (Salmon et al., 2007 ; Wood, 2004) ; une réduction des risques en lien avec des maladies infectieuses telles que le VIH ou les hépatites B et C (Kerr et al., 2007 ; Lalanne et al., 2024) ; ou encore une réduction des consommations dans l’espace public (Petrar et al., 2007 ; Salmon et al., 2007). Pourtant, l’observation scientifique de tels bénéfices ne se traduit pas nécessairement par un impact dans l’acceptation du dispositif par les citoyens. Ainsi, il peut exister une disparité entre ces preuves scientifiques et les représentations présentes au sein de la population (Barry et al., 2019). Une relative ambivalence semble en effet persister chez les citoyens, car s’ils expriment en général leur soutien et reconnaissent quelques bienfaits aux SCMRs (Bardwell et al., 2017 ; Houborg, Jauffret-Roustide, 2022 ; Thein et al., 2005), ils admettent entretenir des craintes vis-à-vis de ce dispositif, et semblent en demande de preuves concrètes de ses effets positifs (Strike et al., 2015). |
| Public cible : | Intervenant |
| Catalogueur : | Nadja |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||
Documents numériques (1)
|
roose-2025-vingt-ans-de-discours-mediatiques-autour-des-salles-de-consommation-a-moindre-risque-analyse-textometrique-de-la-presse-francophone-belge.pdf Adobe Acrobat PDF |