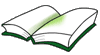|
Résumé :
|
Si les frontières intérieures des Etats de l'Union européenne disparaissent peu à peu et si la libre circulation des personnes devient donc réalité, on ne peut plus faire l'économie d'une réflexion approfondie sur la notion d'ordre public européen et sur les mutations sociales et culturelles en Europe , il s'agit en particulier de vérifier quelles sont les formes d'usage de drogues que la société peut admettre et de chercher à comprendre les liens éventuels entre les expressions d'un manque d'espoir, d'un manque de communication, d'une carence de l'imaginaire et toutes les formes de consommation abusive d'alcool, de médicaments et de stupéfiants. A cet égard, tout en sachant que la problématique des drogues échappe à l'appréhension totalisante du droit, il m'est apparu qu'une analyse des instruments juridiques en vigueur pouvait contribuer à une meilleure compréhension du défi qu'elle représente et pouvait me permettre de suggérer des pistes de travail, des coopérations nouvelles et, peut-être, des réponses plus adéquates, respectueuses tant de la liberté individuelle que de la santé et de la sécurité publiques.Les deux parties centrales de cette étude concernent d'une part la coopération internationale en matière de lutte contre la drogue et d'autre part les instruments juridiques nationaux et internationaux adoptés dans ce domaine. Par ailleurs, dans l'optique d'une bonne compréhension des problèmes actuels et des débats qui se poursuivront au cours des prochaines années, j'ai voulu, dans une première partie, rappeler l'histoire des drogues, préciser les aspects multiples de cette problématique et montrer le caractère récent de l'émergence d'un droit de la drogue. Enfin, dans la quatrième partie, quelques réflexions sont proposées en matière de prévention de la consommation des drogues et de traitement des toxicomanes , elles visent notamment à proposer un modèle psycho-médico-social de gestion de l'usage abusif de drogues et à intégrer ce modèle dans un cadre juridique cohérent.
|