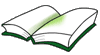|
Résumé :
|
Pourquoi certains individus enfreignent-ils les manières de se conduire de la majorité de leurs congénères ?A cette question, la criminologie répond en essayant de rendre compte du type, de la fréquence et des causes des violations de la loi dont la justice a à connaître et à traiter. La réponse de la sociologie est bien différente : parce qu'elle considère comme criminel tout acte qui provoque une sanction, elle s'efforce de comprendre comment un acte se transforme en infraction et comment se décide et s'applique la peine prévue pour prix de la réparation de la faute constatée.Ainsi, au lieu de s'en tenir aux crimes et délits tels qu'ils sont définis par les articles de loi, la sociologie appréhende-t-elle le fait de commettre une infraction comme unique phénomène : la déviance. Mettre en évidence les principes qui organisent le partage entre le conforme et le déviant : tel est le projet de la sociologie de la déviance. Il n'est alors pas étonnant de constater qu'elle en vient, insensiblement, à affronter une interrogation qui a cessé d'être celle de la criminologie : ' Qu'est-ce que la normalité ? 'La sociologie de la déviance ne figure donc pas seulement l'un des domaines spécialisés de la sociologie. Elle en est la face cachée, révélatrice et critique à la fois. C'est cette autre face de la sociologie que cet ouvrage explore. L'essentiel des théories de la déviance proposées depuis le débat de ce siècle y est retracé, qu'il s'agisse de théories causales, fondées sur les tentatives faites par l'analyse quantitative pour avancer une explication de la criminalité à partir de variables sociales ou psychosociologiques, ou compréhensives, qui envisagent l'infraction à partir de la réaction sociale qu'elle provoque. En exposant les thèses défendues par ces différentes théories, ce livre est, en quelque sorte, l'occasion d'accomplir un périple au cour de la pensée sociologique : suivant le fil conducteur de l'analyse de la déviance, il propose une description des fondements et des limites du culturalisme, du fonctionnalisme, du structuro-fonctionnalisme, des interactionnismes, de l'ethnométhodologie et des théories de l'acteur rationnel.
|