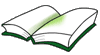|
Résumé :
|
Le goût de la drogue est présent dans toutes les cultures, mais la contrainte qui lie le toxicomane à sa drogue peut être aussi un goût. Un tel fil conducteur, s'il permet à l'auteur de passer de l'étude culturelle à l'analyse clinique, ne va pas sans appuis (contextes culturels nettement délimités, corpus de textes cliniques).Le XIXe siècle, puis les années 60 sont les toiles de fond où s'illustre la place de la drogue dans l'imaginaire littéraire (Balzac, Baudelaire), dans le récit autobiographique (Dostoïevski), dans l'expérience scientifique (Freud et la cocaïne) ou personnelle (Burroughs, Michaux, les hippies).Des cliniciens qui font autorité, comme Olievenstein, Bergeret ou Jeammet, disent que le lien contraignant à la drogue, autour duquel s'organise la vie du toxicomane, s'établit là où les liens interpersonnels ne peuvent se construire, faute d'assises narcissiques un tant soit peu sûres.Dès lors, soigner les toxicomanes, c'est à la fois proposer d'autres étayages (le contenant institutionnel de la cure de sevrage, le traitement de substitution), réveiller la subjectivité (la psychothérapie), et aider ceux qui les soutiennent (les proches). Quant à l'indispensable prévention, s'il lui faut nécessairement s'inscrire dans un cadre institutionnel (famille, école, collectivité locale), elle pourrait, tout compte fait, n'être qu'une attention obstinée à toutes les potentialités des jeunes.
|